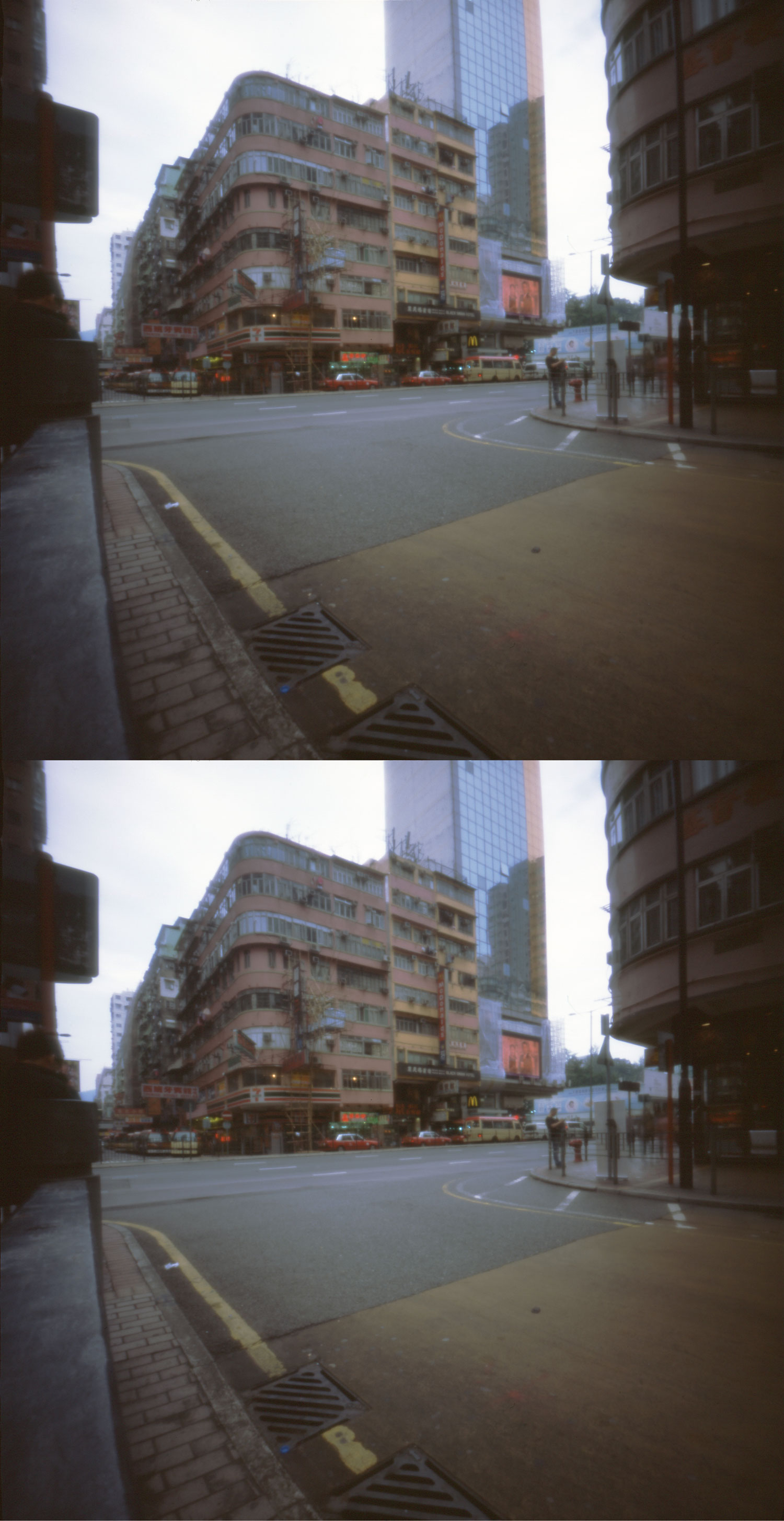L'entretien a été mené par Célio Paillard, sans préparation préalable, par Skype. Il a été retranscrit à partir d'un enregistrement sonore (de mauvaise qualité) et mis en forme en langue plus écrite.
Des discours vocationnels
L'Autre musique (LAM)
Dans votre ouvrage, Les Musicos. Enquête sur des musiciens ordinaires1 La découverte, Paris, 2007. , vous indiquez que le statut de musicien, avant de refléter une réussite professionnelle ou artistique, témoigne d'une implication dans la musique de ceux « qui ne font que ça ». Est-ce une forme d'engagement ?
Marc Perrenoud (MP)
Il y a une ambiguïté autour de la notion d'engagement. En effet, bien souvent, pour devenir un « musicien professionnel », il faut renoncer à être un « artiste ». Je mets des guillemets évidemment à « musicien professionnel » comme à « artiste » puisque, dans tous les cas, ce ne sont pas des statuts gravés dans le marbre, ce sont des constructions sociales et historiques. La vie quotidienne d'un musicien ordinaire aujourd'hui est en général plus proche de ce qu'on pourrait appeler un artisanat que de la figure sociale de l'artiste, autonome, individu singulier, créateur, etc. Je l'ai d'ailleurs constaté lors des entretiens que j'ai menés pour étayer mon livre. Nombre des musicos ont réfuté cette identité d'artiste, en me disant : « Je ne suis pas un artiste, je suis un bon faiseur, je suis un bon artisan. » Certains revendiquaient même une espèce d'identité d'ouvrier. On m'a dit parfois : « Moi, je suis un ouvrier de la musique », principalement ceux officiant dans les orchestres de bal-variété, qui existent encore beaucoup dans le sud-ouest.
Il faut remarquer également une forme d'ambiguïté dans cette notion d'engagement, dès lors qu'on la rapproche de la notion de croyance, en particulier celle décrite par Bourdieu, notamment dans ses textes relativement tardifs, croyance qu'il assimile à la notion d'illusio : quand on croit à quelque chose, c'est forcément qu'on se trompe, un petit peu. Pour Bourdieu, il y a une forme d'illusion par rapport au réel. Par exemple, sur le plan purement économique, les carrières artistiques sont presque systématiquement vouées à l'échec. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. C'est une constante tout à fait systématique dans les carrières artistiques, chez les musiciens comme chez les autres. La très grande majorité des musiciens ordinaires ont démarré leur carrière en espérant devenir riches et célèbres et la quasi totalité d'entre eux ne le sera pas. On ressent chez ceux-là une forme d'échec, de renoncement et de rationalisation lorsqu'ils se disent : « O.K., je ne serai pas Jimmy Hendrix mais est-ce que je peux au moins gagner ma vie avec la musique ? » L'engagement dans la musique ne veut plus dire la même chose à 15, 20, 25, 30 ou 40 ans ; on revoit, souvent inconsciemment, les modalités de son investissement, ce à quoi on croit finalement. Il y a une histoire, une carrière de l'engagement.
En fonction de la connaissance qu'on a du milieu, en fonction de son propre parcours dans le milieu, dans la carrière, etc., on aura tendance à rationaliser et à essayer d'expliquer, à justifier le fait qu'on n'a pas connu le succès, qu'on n'est pas devenu riche et célèbre, mais que malgré tout... Soit on est un artiste maudit et on se maintient dans une position d'individu singulier créateur, autonome ; généralement, ça veut dire qu'on ne gagne pas sa vie avec ce métier. Soit on est devenu un artisan, voire un ouvrier, compétent, avec un savoir-faire technique à peu près assuré, mais on a largement laissé de côté les notions d'inspiration, de création, d'autonomie, de gratuité, tout ce qui distingue justement l'art de l'artisanat.
Là aussi, est-ce qu'on va continuer à croire en ce qu'on fait ? Bourdieu dit que la croyance renferme une dimension d'illusion, mais l'illusio est ce qui nous permet de croire que le jeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette carrière ? À 40 ou 45 ans, ça fait 20-25 ans qu'on fait ça, on n'a jamais réussi à gagner correctement sa vie, on vivote, on survit, ça rend très difficile une insertion sociale, en terme de mise en couple, de projet, de procréation, etc., y compris en terme de consommation quotidienne, de logement, de voiture... On manque d'argent, on vit la précarité depuis des années… Pour quelles raisons se maintient-on dans cette carrière, continue-t-on à croire en quelque chose, à s'engager ? Voilà quelque chose de très particulier, de tout à fait passionnant pour un sociologue.
On a couramment affaire à des profils d'individus qui sont plutôt bien formés, qui ont des diplômes, comme en musique, en interprétation, pas forcément du conservatoire mais souvent dans des écoles conventionnées, des gens qui ont fait des études musicales parfois relativement longues, qui ont un niveau de virtuosité assez élevé sur leur instrument. Ce sont de très bons musiciens, qui passent de nombreuses heures, beaucoup plus de 35 par semaine, à travailler leur instrument, à monter des projets musicaux, à démarcher, à essayer d'obtenir des dates de concert, des engagements au sens professionnel, d'emploi, et qui sont très mal rémunérés, compte tenu de leur niveau de formation, du temps et de l'énergie qu'ils consacrent à leur activité au quotidien. Cette rémunération, pécuniaire mais aussi symbolique, est gagnée dans des conditions peu gratifiantes en général : il s'agit fréquemment de jouer dans des bars pour quelques dizaines d'euros au noir, avec protection sociale réduite au minimum, la retraite n'étant même pas évoquée. Ce sont des situations de grande précarité dans lesquelles les gens continuent malgré tout à s'engager.
LAM
Lorsqu'il m'arrive de parler de mes activités artistiques à des amis, je devine chez certains d'entre eux, qui ne connaissent pas ce milieu, une espèce de regard un peu envieux, une vision fantasmée de la vie merveilleuse des artistes (vie qu'ils n'oseraient toutefois pas mener). Pourtant, il me semble qu'être artiste, c'est précisément abandonner ses rêves, et en particulier les espoirs de bénéfices économiques, voire symboliques. Car quand on a compris tous les désavantages qu'il y a à « ne faire que ça », la question de la légitimité ne se pose plus qu'à l'intérieur de la pratique. L'engagement est alors d'autant plus fort qu'on a peu d'espoirs de rémunération, mais un besoin de faire ce qu'on estime irrépressible, ou une incompétence à faire autre chose.
MP
Dans une large mesure, ce sont des discours récurrents. Soit sur un mode très vocationnel comme vous disiez « on ne peut pas faire autre chose », ce qui est une manière de naturaliser sa pratique (c'est en nous, on ne peut pas lutter contre ça). Soit sur un mode un plus prosaïque et matériel en disant « Je ne sais rien faire d'autre. » Je pense à un batteur notamment, qui est intermittent depuis plus de 20 ans maintenant, un de mes meilleurs amis par ailleurs et en même temps un des musiciens avec qui j'ai le plus joué dans ma vie. On a régulièrement ce type de conversations, puisque ça fait pratiquement 20 ans qu'on se connait et qu'il me répète « Je ne fais que ça parce que je ne sais rien faire d'autre, que veux-tu que je fasse ? » C'était au départ une forme de vocation, de nécessité, c'est devenu un métier. Car il y a en musique, plus que dans la plupart des autres disciplines artistiques, la possibilité d'en faire un métier, un job très quotidien, qui s'exerce finalement selon des modalités assez peu artistiques, du moins dans le sens romantique du terme.
Le métier de musicien peut vite devenir celui de prestataire de service à proprement parler. Il n'y a pas d'autres expressions, de mots différents. Pour décrire les activités du plasticien, il y a des mots différents : être maquettiste ou être graphiste, ce n'est pas exactement la même chose que d'être artiste-plasticien. Quand on exerce ses talents de plasticien pour une commande, pour faire une plaquette publicitaire, ou pour illustrer quelque chose, on n'a pas le même statut. Chez les musiciens, c'est le même mot, que l'on fasse une création de musique improvisée dans un centre d'art contemporain, donc quelque chose de très légitime, très autonome où on est très libre, ou bien que l'on joue des reprises de variété pour un banquet du Rotary-Club ! Cette espèce de plasticité identitaire est très particulière au travail des musiciens. Un weekend, on est un artiste qui joue en concert, dans un festival, quelque chose de singulier, et peut-être que le weekend suivant on sera un prestataire de service, un factotum.
Cette ambiguïté fondamentale est liée à l'engagement dans la carrière, musicale en particulier. Parce que chacun a besoin, malgré tout, de maintenir un minimum d'estime de soi, quand on commence à multiplier les plans d'animation anonymes, les moins avouables et les moins rémunérateurs, sur le plan symbolique j'entends, et qu'on joue de moins en moins souvent dans des situations de concert ou justement on est plutôt dans une situation et une position sociale d'artiste, ce n'est pas évident de maintenir cet engagement et de continuer à se persuader que le jeu en vaut la chandelle, même si on tient un discours vocationnel : « J'ai ça en moi, je ne pourrais jamais rien faire d'autre… » (Mon travail, en tant que sociologue, est justement d'aller au-delà de ce discours convenu.)
Une autre façon de vivre sa vocation, de vivre le rapport à l'art, c'est justement de renoncer à vivre par son art, pour vivre pour son art. C'est le cas de certains musiciens que j'ai rencontrés, qui avaient renoncé à « faire le métier » (selon l'expression consacrée), qui avaient renoncé à tous ces plans d'animation, d'entertainment, etc., qui avaient repris un travail à la ville, un day-time job comme disent les Anglo-saxons, et qui se retrouvaient alors dans une situation d'indépendance financière par rapport à la musique. Leur activité musicale n'ayant plus besoin d'être rentable, elle se trouvait libérée d'une certaine manière, dans un régime de gratuité, d'autonomie maximum. « On n'a plus besoin de plaire ni à des programmateurs ou à des patrons de bar, ni à un public, on fait ce qu'on veut. » C'est ce qu'on pourrait appeler des « marchés de niche », dont fait partie la musique improvisée radicale, de la musique évidemment non rentable. J'ai rencontré des musiciens qui ont reconquis leur autonomie et leur liberté en renonçant à ne faire que ça, en renonçant à une certaine professionnalité, dans un sens strictement économique. C'est un mode d'engagement qui est très fort lui aussi, mais qui se découple complètement de celui mis en œuvre dans une carrière professionnelle à proprement parler.
LAM
C'est une manière de revenir, à l'idée du jeu au sens général ; quand on parle du jeu, on peut avoir le sentiment qu'il n'y en a qu'un seul et que tous les acteurs de ce monde de l'art en particulier y sont engagés. Ils ont les mêmes règles, dans une certaine mesure, mais ils ne les pensent pas de la même façon, et peut-être aimeraient-ils que les règles soient différentes. Si on revient dans le champ des arts plastiques, pour un artiste, pour une galerie ou un centre d'art, pour les DRAC, les mairies ou les institutions qui donnent de l'argent pour que ça se produise, les règles ne sont pas les mêmes. J'ai l'impression que quand on est artiste, on se sent plus de légitimité à définir comment elles devraient être, alors que ce ne sont jamais les règles des artistes qui peuvent s'imposer, dans la mesure où, de toute façon, ils n'ont pas la possibilité de s'exposer par eux-mêmes. Ils n'ont pas les financements, ils n'ont pas les moyens techniques…
MP
Je citais Bourdieu tout à l'heure mais je vais revenir au deuxième de mes grands maîtres qui est Howard S. Becker, dont vous venez d'utiliser l'expression du « monde de l'art ». Un artiste tout seul n'est rien, n'existe pas au sens social du terme. Pour qu'une œuvre d'art existe, il faut tous les ingrédients. Il ne faut pas seulement un artiste et un public, il faut aussi des intermédiaires extrêmement nombreux en amont, des fournisseurs, des partenaires, etc., ou, en aval, des diffuseurs, des galeristes, des programmateurs… Toute une histoire sociale de l'art serait complètement à refaire par rapport à une vision de l'histoire de l'art que Bourdieu qualifiait de « scolastique ». Il faudrait la revoir en la relativisant et en la ramenant justement au niveau de la diversité des acteurs qui peuplent les mondes de l'art. Des gens comme Howard S. Becker ou Raymonde Moulin en France, ont déjà commencé à le faire.
Becker dit que ça ne fonctionne dans les mondes de l'art que si on s'entend autour de conventions communes. Cette notion de convention est centrale. Il faut que l'artiste, les différents intermédiaires et le public s'accordent sur un certain nombre de conventions communes. On peut imaginer, chez des artistes, une volonté de se libérer, d'être complètement autonomes, d'édicter eux-mêmes les règles du jeu comme vous le disiez, mais quand ça se passe comme ça, on aboutit généralement à ce que Becker appelle « des artistes francs-tireurs » qui, en ne respectant pas les conventions du monde de l'art, s'en excluent par eux-mêmes. C'est le cas du compositeur Charles Ives, par exemple, quand il compose des symphonies pour un millier d'instruments. Quelles que soient les qualités de ces œuvres, elles ne seront jamais jouées parce qu'elles ne rentrent pas dans les conventions purement matérielles. C'est basique mais ça commence là. Un artiste peut se penser comme un grand inspiré, comme un homme totalement autonome et singulier, mais s'il veut avoir la chance d'exister un jour, c'est-à-dire de voir ses œuvres rencontrer le public, il lui faudra en passer par un minimum de conventions.
Pendant pratiquement tout le XXe siècle, on a connu toute l'histoire de ce hiatus entre une identité sociale de l'artiste, qui est renvoyé à la gratuité, à l'autonomie, à la liberté totale, etc. et l'inscription du travail artistique, malgré tout, dans un marché et/ou dans un système de subventionnement ; c'est l'un ou l'autre, voire les deux. Que ce soit le marché, donc la sanction libérale du commercial, ou que ce soit le subventionnement, on voit bien dans les deux cas que ce n'est pas de l'autonomie. Soit on est contraint par le public, le commerce, la demande, soit on est contraint par le mécène, le fait du Prince, le goût des subventionneurs. Dans tous les cas cette situation est très paradoxale, balançant entre un idéal romantique (issu du XIXe siècle), d'autonomie totale, de singularités créatrices, et d'un autre côté des conditions d'exercice du métier qui sont difficilement compatibles. C'est un peu toute l'histoire de la figure de l'artiste au XXe siècle : comment faire, comment se situer par rapport à ça ?
Pour certains, ce fut le jusqu'auboutisme romantique, la culture de la bohème, la misère : moins on a d'argent, meilleur on est ! Le fait d'être pauvre et inconnu devient le meilleur gage de l'indépendance, de l'autonomie. C'est comme ça que s'est construite La gloire de Van Gogh2 La Gloire de Van Gogh, Essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, Éditions de Minuit, 1992. , pour reprendre le titre d'un livre de Nathalie Heinich. Elle y explique que si Van Gogh est aujourd'hui, probablement, la plus grande figure du peintre superlatif (avec Picasso, peut-être), c'est parce qu'il est mort fou et dans la misère : une forme d'autonomie, de liberté, d'engagement jusqu'au bout. Van Gogh est l'exemple de celui qui n'arrive pas à vivre par son art, mais qui vit pour son art. Au XXe siècle, certains se sont accrochés à cette figure mythologique, d'autres l'ont prise à contre-pied (de Duchamp jusqu'à Warhol ou Jeff Koons aujourd'hui). C'est alors encore autre chose : avec ce code, on se rit de la figure romantique de l'artiste libre, singulier, pur, que l'on considère un peu comme une escroquerie.
L'art contemporain est devenu une machine tellement puissante qu'elle arrive à tout intégrer. Aujourd'hui, c'est devenu une posture extrêmement rentable. Mais on peut se demander si, depuis la fin des années 80, on n'est pas en train de revenir vers une figure de l'artiste qui serait en rupture avec l'idée romantique de l'artiste individu singulier, créateur, totalement pur et autonome, pour se diriger vers une figure qui serait celle de l'artiste entrepreneur. Jeff Koons en est un exemple parfait : costard-cravate, un passé de trader ou, du moins, dans la finance…
L'intérêt au désintéressement
LAM
On peut penser également à Damien Hirst, ou à Wim Delvoye, avec la société qu'il a montée pour produire Cloaca. Ces artistes assument la dimension entrepreneuriale de leur métier.
MP
Dans le spectacle vivant également, de plus en plus de gens arrivent à vivre de manière satisfaisante (en tout cas, si on les écoute) le fait d'être à la fois musicien, chorégraphe ou comédien, donc artiste, et d'exercer en même temps dans un marché, dans un espace subventionné, de faire avec les contraintes, que ce soit celles du public ou celles des subventionneurs, en sortant d'une position strictement romantique. (En dehors d'un engagement totalement pur, dans une vie complètement dédiée à son art, il n'y aurait point de salut.) On trouve, me semble-t-il, de plus en plus de formes d'engagements hybrides, où on s'engage dans la création artistique et en même temps dans une forme entrepreneuriale. On a conscience du fait que l'un ne va pas sans l'autre finalement, ou que, si on veut rester dans un engagement autour d'une idée de la pureté artistique, on se condamne, soit à la misère, soit à avoir un boulot à côté.
LAM
Ce que vous dites me fait penser au livre de Bourdieu, Les règles de l'art3 Paris, Seuil, 1992., dans lequel il explique le début du processus d'autonomisation dans la littérature, puis dans la peinture, les arts plastiques, etc. Il montre l'importance stratégique pour les artistes de pouvoir dire « Nous animons un champ à part, nous seuls sommes capables de déterminer ce qu'il a de spécifique. » Car c'est aussi un moyen d'essayer de se dégager de la pression des commandes tout en continuant à vivre grâce au soutien des bourgeois qu'ils honnissent.
La démarche est doublement essentialiste, pour déterminer ce qu'est un artiste (comme si c'était une espèce humaine à part) et quelle est sa pratique (ce qui est plutôt l'approche moderniste jusqu'aux années 60). Alors, pour se sentir inséré dans le milieu, on peut avoir envie d'en subir les contraintes, de gérer des emplois du temps compliqués, de passer de tel à tel endroit, de travailler pour des commandes. Un tel engagement, souvent au second degré, est plus proche du post-modernisme.
Pour faire écho à la composition aux mille instrumentistes de Charles Ives, on peut parler de la pièce Helikopter-Streichquartet de Stockhausen, autre œuvre typiquement injouable puisqu'interprétée par 4 musiciens, chacun étant dans un hélicoptère différent. Elle a pourtant été jouée lors de la dernière Nuit blanche à Paris et on peut critiquer la grande dépense d'argent public qu'elle a du nécessiter. Pourtant, c'est aussi par le refus de telles préoccupations matérielles que Stockhausen a (sciemment) entretenu sa posture d'artiste4 Voir « L'Informe nominaliste », communication de Gérard Pelé au colloque Musica Futurista, 25 & 26 septembre 2013, Halle St Pierre, Paris. .
MP
Effectivement, quand on a une position suffisamment forte, suffisamment favorable, le spectacle de l'inutile, le spectacle de l'engagement et celui du désintéressement peut engendrer un renforcement des positions, un renchérissement du prix des œuvres, etc. Cela fait partie de ce que Bourdieu appelle « l'intérêt au désintéressement », notion aussi extrêmement importante, qu'il n'a pas développée pour pointer du doigt des stratégies machiavéliques, marketing ou autre. Dans le cas de certains artistes contemporains, que ce soit en musique ou en arts plastiques, il y a je pense un peu de stratégie marketing, mais dans la majorité des cas, je dirais que c'est une démarche tout à fait sincère, pas particulièrement calculée que de tenir une posture désintéressée, qui va finalement engendrer du profit. Si on tient cette posture désintéressée tout en bas de la pyramide, ça n'apporte pas grand chose ; certes, on est pur, mais on l'est comme l'a été Van Gogh dans sa petite cabane, avec rien à manger. Mais si on est déjà en haut, ça peut être extrêmement rentable.
Prenons l'exemple tout à fait récent de ce qu'a fait Banksy. Il a demandé à quelqu'un de vendre ses oeuvres dans la rue, à New York, et cette personne (je ne sais plus si c'était un SDF ou un artiste très peu connu) les a vendues pour quelques dizaines de dollars. C'est typiquement un acte désintéressé, mais il y a un intérêt formidable à le faire, quand on s'appelle Banksy. Cela relève complètement de l'intérêt au désintéressement, mais je suis sûr qu'il ne fait pas ça uniquement pour faire du buzz, pour augmenter le prix de ses œuvres par exemple ; je suis sûr qu'il fait ça de manière véritablement désintéressée, pour dire : « Ça suffit, le marché de l'art contemporain, c'est n'importe quoi, moi je fais du street art, ça ne devrait pas être cher. » Il arrive à jouer sur ces deux tableaux d'une façon assez fascinante, à tenir à la fois l'engagement artistique à proprement parler et l'engagement professionnel, dans le sens emploi ou engagement dans une carrière professionnelle, à tenir les deux bouts diamétralement opposés de cette figure ambiguë de l'engagement.
LAM
Ça me fait penser au bénéfice symbolique que peuvent retirer certains groupes de musique, notamment de rock, en écrivant des chansons aux paroles engagées (dans le sens politique), et en essayant de faire passer des « messages ». Je pense, par exemple, au groupe Rage against the machine, dont le premier album, qui fut un grand succès, avait une dimension ouvertement politique, de par les textes des chansons et toute l'imagerie associée, autour de la figure de Che Guevara. Je suppose que cela a pu inciter de nombreuses personnes à acheter leur disque.
MP
Bien sûr. Il serait intéressant de savoir, connaître, raconter avec précision comment les choses se sont déroulées. Car, en 1991 ou 92, le groupe n'était pas connu, mais l'album est quand même sorti sur un très gros label. C'est aussi une forme d'ambiguïté pour ces artistes, quelle que soit leur discipline, qui ont accès à des moyens très importants : diffusion, encadrement technique, roadies qui portent les amplis, attachée de presse qui passe les coup de fil… Pour ceux qui ont accès à tout cela, se pose la question de la coexistence du discours engagé politiquement et des pratiques de vie de rock-star. Leur quotidien est extrêmement privilégié, ils sont entourés de serviteurs aux petits soins et, en même temps, dans les représentations, ils ont une position charismatique, font chanter ou taper dans les mains des milliers de personnes à la fois comme le ferait un gourou… C'est toute l'ambiguïté de ce jeu, qui n'est plus celui des musicos en bas de l'échelle, mais celui du show business d'une manière générale, de la société du spectacle, de la mise en spectacle.
Ce n'est pas forcément évident de tenir jusqu'au bout une posture politiquement très engagée et en même temps une participation très large aux diverses conventions du show business. Qu'on parle de Rage against the machine ou d'artistes-plasticiens, de vidéo-artistes et autres, je ne peux pas avoir de discours généraliste là-dessus, parce qu'il faudrait voir au cas par cas comment ça se passe et ne surtout pas distribuer de bons ou de mauvais points. Voir plutôt comment les gens arrivent à vivre avec ça, à trouver une cohérence dans ces situations ambiguës, ces situations paradoxales entre les différents sens et formes que peuvent prendre les notions d'engagement.
Y croire ou ne pas y croire
LAM
Peut-on dire que, quand on s'engage vraiment, on est capable de gérer les différentes formes d'engagements, l'engagement pur et l'engagement à l'intérieur de la pratique et que cette pratique en elle-même fabrique aussi un certain type d'engagement ? Dans votre article « Partitions ordinaires : trois clivages habituels de la sociologie de l'art questionnés par les pratiques musicales contemporaines5 Sociétés n° 85, p. 25-34, 2004. », vous avez expliqué que certains musiciens, même s'ils sont dans la pratique et dans le jeu, ont quand même la possibilité d'avoir un regard extérieur vis-à-vis du jeu. Ils savent aussi quels sont les codes en même temps qu'ils les utilisent, comme si on pouvait y croire et être en même temps capable de comprendre qu'on y croit et de jouer avec ces normes et ces croyances.
MP
Pendant toutes ces années où j'ai fait du terrain, j'ai été musicien et ai souvent partagé le quotidien de ces musiciens ordinaires ; j'ai été frappé de voir à quel point, d'un instant à l'autre et presque en même temps, on pouvait y croire et ne pas y croire. Je prends souvent l'exemple d'une prestation en musique improvisée radicale, quelque chose un peu au-delà du free jazz, d'assez exigeant… Dans les loges, 5 minutes avant de jouer, on pouvait rigoler à propos de ça, avoir une espèce de cynisme : « On va faire du bruit, on va faire n'importe quoi, de toute façon, ces bobos, ils ne s'en rendront même pas compte, etc. » On pouvait tenir un discours vraiment poujadiste, très cynique. Cela venait souvent d'un musicien qui était effectivement d'origine sociale populaire ou de toute petite bourgeoisie, un musicien sans réel profil d' « artiste » avec un fort capital culturel. Ces gens qui se pensent plutôt comme des artisans ont développé un habitus de type artisanal et, dans les loges, juste avant d'aller jouer ce genre de musique, ils sont extrêmement cyniques, désenchantés ; mais au moment d'aller sur scène et de jouer, ils croient à ce qu'ils font. On doit croire à ce qu'on fait sinon on ne peut pas le faire. Parce que justement c'est de la musique improvisée, parce qu'on aime faire ça, parce qu'on est engagé, comme vous dites, dans cette pratique, fondamentalement, parce qu'on ne fait pas ça par hasard ni parce que ça rapporte, on le fait parce qu'on aime faire ça, on trouve ça intéressant, on s'engage dans cette pratique et donc, au moment où on est sur scène et où on joue, il n'est absolument plus question de prendre ça au second degré, de faire de l'ironie ou de l'humour facile sur les bobos ou les intellos qui composent le public. J'ai toujours trouvé ça fascinant.
Ça me permet de rebondir sur d'autres travaux que j'ai pu mener après ceux sur les musiciens. C'est justement toute cette ambiguïté qui m'a fondamentalement intéressé et poussé à enquêter auprès d'un autre groupe professionnel sans grand rapport avec celui des musiciens, puisqu'il s'agissait de maçons et de charpentiers d'un canton des hautes Corbières. Il me semblait possible de démontrer que ce canton était dans un processus de gentrification rurale, un fort embourgeoisement avec l'arrivée de néo-résidents d'Europe du Nord, américains ou parisiens, des gens qui achetaient des vieilles fermes ou des bergeries pour une bouchée de pain, des gens nantis et dotés d'un fort capital culturel également, producteurs de télé, éditeurs… Alors sont apparues de nouvelles figures d'artisans du bâtiment, des artisans qui justement charriaient avec eux non seulement un savoir-faire du métier, mais aussi un savoir-faire tout à fait théorique et même, pour certains, une forme d'inspiration. On a vu arriver des maçons-créateurs, des gens en mesure, de par leurs dispositions sociales, de vendre à leur « client » beaucoup plus qu'un simple mur en pierres. Ils leur vendaient aussi l'histoire qui va avec, un échange social, des discussions tournant, par exemple, autour de la distribution des volumes dans la maison, chose que les maçons traditionnels du coin étaient incapables de faire, car beaucoup plus dans un rapport direct et pragmatique à l'activité.
Une des questions au cœur de mes travaux, en tant que sociologue, est celle des identités au travail entre l'art et le métier. Il m'a semblé qu'avec les musiciens ordinaires, j'avais affaire à ce que j'appelle des « artistes déclassés » qui vivaient leur art beaucoup plus comme un métier pour une grande partie d'entre eux. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller chercher ce que j'appelle des artisans surclassés, donc ces maçons-créateurs qui vivaient leur métier comme un art (pour certains) avec un discours vocationnel.
C'est la question de la croyance en ce qu'on fait, de l'ambiguïté existant autour de ces formes de croyance. Entre posture désintéressée et stratégie marketing, il y a une zone grise où on n'est ni complètement dans l'un, ni complètement dans l'autre, mais entre les deux et c'est ce qui m'intéresse. Je suis parti des musiciens, mais aujourd'hui je travaille sur d'autres groupes professionnels, en me posant le même type de questions.
LAM
Il me semble que cela rejoint mon idée de la pratique ; quand on développe une pratique, on navigue entre les deux, entre un aspect de l'ordre du physique, du corporel, de l'hexis comme dirait Bourdieu, de gestes et de mouvements d'une connaissance assez physique et, en même temps, il y a des questionnements sur ce qu'on est en train de faire et des ajustements en permanence.
J'aimerais vous poser une question par rapport à vos pratiques, de musicien et de sociologue : comment avez-vous fait pour être à la fois engagé dans la musique et en même temps capable, non seulement de regarder votre propre pratique, mais aussi celle des autres et de vous poser toutes ces questions ?
MP
C'est une question qu'on me pose souvent, comme à tous les ethnographes qui appartiennent à la population qu'ils étudient.
Une double réponse : d'une part, cela pose le problème général du rapport à l'objet d'étude et, finalement, le rapport du chercheur à son objet d'étude se pose toujours ; qu'on en soit très près ou qu'on en soit fort éloigné. On ne pense pas à poser ces questions-là à un statisticien qui n'a jamais rencontré les populations sur lesquelles il écrit des pages entières à partir de données de seconde main, alors qu'il ne sait pas du tout dans quelles circonstances ou dans quelles conditions les questionnaires ont été remplis. (On sait très bien qu'en général les enquêteurs remplissent le dernier quart des questionnaires eux-mêmes, en inventant les réponses pour finir les quotas, etc.) Je pense que le rapport d'un chercheur à son objet doit toujours être pris au sérieux, que cette question doit vraiment faire partie de la recherche et ce, quel que soit le degré de proximité entre l'enquêteur et son objet.
Deuxième réponse un peu plus précise : dans le cas de l'observation participante ou de la participation observante, quand on appartient à la population que l'on étudie, dans le cas où on accomplit les gestes, les activités, les pratiques sur lesquelles on travaille par ailleurs en tant qu'observateur, il me semble indispensable de tenir autant que possible la position dont parlait Bourdieu en l'appelant « l'objectivation participante ». Il s'agit d'objectiver au maximum son propre rapport au terrain, d'essayer de se rendre compte des divers intérêts que l'on pourrait avoir à écrire ceci ou cela, à voir les choses comme ci ou comme ça en fonction du fait qu'on a un pied dans la musique, un pied dans le monde académique. Par exemple, j'aurais probablement pu forcer un peu le trait sur le caractère exotique, sur les anecdotes qui sortent de l'ordinaire, sur le côté un peu picaresque pour faire effet sur un jury de thèse.
J'aurais tiré des bénéfices académiques relativement importants en jouant sur cette corde-là ; c'est extrêmement facile et les gens ne demandaient pas mieux, que ce soit le jury de thèse ou, par la suite, le public des colloques. Au cours des années 2000, j'aurais pu en tirer partie, mais je m'y suis refusé parce que j'objectivais ma position, me disant que je n'étais pas là pour ça. Je voulais essayer de combattre cette tentation de l'exotisme, de l'anecdote croustillante sur les coulisses de la musique ou autre, pour au contraire prendre les choses de manière assez neutre, car je considérais que tout ça est un travail. J'ai du faire une analyse de ma propre position dans le champ en tant que jeune, musicien, insider, donc attendu par les mandarins sociologues comme le gars qui va bien faire rigoler avec des trucs drôles mais peut-être pas très sérieux. Objectiver sa propre position, c'est à la fois s'interroger sur le terrain : qui je suis, un jeune apprenti musicien (enfin, au tout début) ; mes propres désirs de faire carrière dans la musique ; et mon besoin de saisir comment fonctionne ce milieu-là pour y faire carrière. Et c'est aussi en étant sociologue qu'on peut le comprendre. Je devais avoir conscience du fait que j'avais différentes formes d'intérêts qui se recoupaient largement, essayer de les objectiver, de les neutraliser.
Ce n'est pas facile d'objectiver la position qu'on peut tenir dans le champ de la musique, son rapport à la musique et aussi au champ académique de la sociologie, son rapport à la sociologie et donc être conscient de ses propres intérêts (sans pour autant combattre, ce qui serait ridicule), mais, en tout cas, être conscient de la place où se trouvent ses propres intérêts, sans trop se bercer d'illusion, et se dire régulièrement : « Je ne vais sûrement pas faire ça parce que je vais plutôt privilégier une forme de rigueur scientifique », ce qui est aussi un intérêt à long terme. Le doctorant qui fait une thèse séductrice, croustillante et drôle, « sex, drugs and rock'n roll », fait bien rire le jury de thèse mais, à long terme, il lui sera plus compliqué d'obtenir un poste. On trouve toujours ses propres intérêts. Il est plus difficile d'être vraiment conscient de ses différents enjeux et de sa propre place dans ces différents enjeux, dans les deux champs, le champ de l'objet observé et le champ académique. Mais c'est cette posture d'objectivation participante qui m'a permis de mener à bien mes travaux.
LAM
Dans certains cas, en tant qu'artiste, plasticien, musicien, etc., ne peut-on pas aussi être amené à objectiver sa position dans la mesure où ça peut aussi servir ses intérêts ?
MP
Oui, mais le but n'est pas le même. L'objectivation participante a pour visée de publier des travaux scientifiques qui ne seraient pas baignés d'illusion. Le travail de réflexivité et l'objectivation quant à sa propre position est toujours quelque chose de bénéfique, que l'on soit plasticien, sociologue ou footballeur.
Pour finir, je vais vous donner une ou deux nouvelles sur ce que je fais actuellement. Je suis en train de développer une comparaison internationale sur les carrières de musiciens et musiciennes, dans un gros programme de recherche, ici, en Suisse. Des contacts sont en train de se nouer et devraient se concrétiser dans les mois qui viennent avec les États-Unis, avec des gens qui font des travaux comparables avec ce que j'ai pu entreprendre en France et ce qu'on fait actuellement en Suisse, incluant toute une partie quantitative, des enquêtes statistiques sur les carrières de musiciennes et musiciens en Suisse. Je suis loin d'avoir abandonné cet objet-là. Aujourd'hui, nous en sommes à la comparaison internationale : France, États-Unis, Suisse, peut-être des pistes au Chili aussi…
LAM
Des musiciens ordinaires encore.
MP
C'est la très très grande majorité. Ceux qui deviennent riches et célèbres sont exceptionnels, ce sont ceux qui sortent de l'ordinaire. On est confronté à ces structures professionnelles pyramidales, où il y a beaucoup plus de monde en bas qu'en haut.